Liste des articles reproduits :
Ciné-Magazine n°7 du mois de juillet 1930 + La Revue de Cinéma n°17 du 01 décembre 1930 + La Libre Belgique, le 27 octobre 1933 + Pour Vous, 30 novembre 1933 + Pour Vous, n° 289, 31 mai 1934 + L’Ecran Français n°22 daté du 14 novembre 1945 + L’Ecran Français n°120 daté du 14 octobre 1947
Ciné-Magazine n°7 du mois de juillet 1930
Groupement de spectateurs d’avant-garde.
Ce groupement a donné le 14 juin une séance sur le jeune cinéma français avec une causerie de Jean Vigo : Vers le Cinéma. social, suivie de la présentation du film de Vigow Kaufman (sic) : A propos de Nice, une oeuvre aux intentions heureuses, mais qui peut très bien ne pas plaire par son hermétisme.
Autres films présentés : Les Sports, inédit de Jean Lods, et Paris-Cinéma, de Chenal et Mitry, intéressantes révélations sur le cinéma.
La séance du 21 juin a été consacrée à Dekenkeleire, un des principaux chefs de l’avant-garde belge et auteur de Combats de Boxe, Impatience, Histoire de Détectives; d’une technique très personnelle et audacieuse, ces orchestrations d’images présentent des déséquilibres évidents.
L’Effort. Pour clôturer « un an d’efforts », le groupement « L’Effort » dont nous avons signalé les habiles séances cinématographiques, a organisé une « soirée cinématographique « chez Georges Méliès il y a vingt ans » et « une soirée au studio 28, en 1930 ».
Agréable confrontation du passé et du présent et dont on peut tirer de très intéressantes conclusions.
Un hommage enthousiaste fut rendu à Georges Méliès, qui voulut bien rappeler quelques-uns de ses plus réjouissants souvenirs.
MAURICE-M. BESSY
La Revue de Cinéma n°17 du 01 décembre 1930
A PROPOS DE NICE. Point de vue documentaire par JEAN VIGO et BORIS KAUFMANN.
Vigo a eu une idée de derrière la tête : comme peu de metteurs en scène possèdent de telles idées, il convient de le féliciter.
Presque tous les documentaires relèvent du haut commissariat au tourisme ou de recherches esthétiques périmées. La place est libre pour des pamphlets cinégraphiques auxquels la sordidité où nous vivons fournira une matière et une espérance inépuisables.
Les rues de Nice, les monuments hôteliers, les faces de chair des hivernants et les têtes de carton du carnaval mourant, les malheureuses tentations sexuelles offertes aux vieux bourgeois, les poules, les vieilles dames également attirées par les petits chiens et les jeunes amants, ces éléments traditionnels de la poésie distinguée peuvent alimenter un réquisitoire dirigé contre cet Eldorado dangereux. On fait briller son or aux yeux des dactylos dont les plus mauvais instincts se réveillent aux sons des romances de la Côte d’Azur : Sur les bords de la Riviera ou Y a bon Carnaval.
Malheureusement l’intention a dépassé l’exécution : au lieu du film tranchant, que lui permettaient les photographies souvent excellentes de son opérateur, Vigo a bâti un film nuageux où le pamphlet est noyé dans des contrastes usés depuis les romantiques.
On voit des gros vieillards ramollis : le comique; puis des ouvriers brûlent les mannequins du Carneval : le tragique. Une vieille dame fait la jolie et jette sur les passants des boules de coton : le plaisir; un cimetière apparaît alors: c’est la mort; tous les spectateurs méditent la vanité de la vies.
Vigo ne nous entraîne pas hors des chemins usés et la bourgeoisie ne s’en porte pas plus mal.
Il est d’autre part naïf de prouver que les bourgeois sont haïssables parce qu’ils sont laids et ronflent en dormant : tous les prolétaires n’ont pas la figure d’un dieu et ce n’est pas la révolution qui guérira tout le monde des polypes et des végétations. Il y a des contrastes, des images plus efficaces contre la bourgeoisie. Jugeons seulement Vigo sur ses bonnes intentions.
Il a achevé d’encombrer son film en faisant appel aux vieilles ficelles; des maisons à l’envers ont soudain le vertige, des vues se répètent inlassablement : sommes-nous belles, disent-elles. On voit une prostituée A, puis une prostituée B, puis C, et soudain miracle ! On comprend que c’est la même. Idée neuve des prostituées interchangeables.
Faites des pamphlets, mais décidez-vous à être pamphlétaires. Qu’ils soient satiriques seulement, ou tragiques, éveillant mépris ou colère, mais toujours coupants et rudes. Ils arriveront bien, par surcroît, à être réussis, et efficaces. (Muet. )
Amable Jameson.
La Libre Belgique, le 27 octobre 1933
UNE INTERVIEW DE JEAN VIGO
Les interviews accordées par Jean Vigo ont été rares, et pour cause. J’ai retrouvé celle-ci dans les documents qu’a bien voulu me communiquer Henri Storck. Signée des initiales L.P., elle a été publiée à Bruxelles dans les pages de La Libre Belgique, le 27 octobre 1933.
PIERRE LHERMINIER
Reproduit dans Jean Vigo de Pierre Lherminier, ed.Seghers.1967.
En un temps où les hommes de quarante ans se réclament de la jeunesse, et surtout s’ils sont gens de cinéma, on est particulièrement heureux de rencontrer quelqu’un dont l’âge explique les enthousiasmes et communique au talent cette sève sans quoi aucune oeuvre durable n’est possible. Tel Jean Vigo. Nous l’avons rencontré quand il vint présenter aux spectateurs bruxellois ce Zéro de conduite qui déchaîna les foudres de la censure française et dans lequel nous n’avons rien vu, pour notre part, qui motivât semblable sévérité.
Vigo a le mobile et fin visage d’un adolescent. Les yeux bruns éclairent des traits un peu irréguliers mais empreints de la plus vive intelligence. Dégageant le front, la chevelure a ces ondulations que l’on prête volontiers aux poètes sur les médailles et les portraits. En bref, une physionomie extraordinairement vivante et tout à fait en accord avec les propos optimistes, presque allègres, que nous tient Jean Vigo.
Comme de bien entendu, nous l’interrogeons tout d’abord sur la situation faite, en France, aux auteurs de film.
– L’avenir est aux indépendants, affirme notre interlocuteur avec une belle assurance. Alors que les grosses compagnies, dont l’équilibre financier se trouve gravement menacé par la crise actuelle, n’osent plus se risquer dans aucune entreprise en dehors du genre strictement commercial, la production en participation, elle, a au contraire – et de ce fait – la voie libre. Un commanditaire apporte l’argent liquide. Un studio fournit son matériel. Une grande maison se charge de la diffusion sur les écrans de la bande ainsi réalisée. Je vois donc approcher sans la moindre appréhension le moment de commencer L’Atalante, que je vais tourner d’après un scénario de Jean Guinée, scénario qui n’est qu’une trame lâche me permettant de mettre en valeur des images du bord de l’eau, dans le monde des mariniers, et l’interprétation…
– Elle comportera…?
– Jean Dasté, que vous avez rencontré dans Zéro de conduite où il incarne le pion Huguet, et Michel Simon. Gendre de Copeau, Dasté a de qui tenir et vous avez pu l’apprécier par vous-même. Quant à Simon, nous avons imaginé pour lui un personnage inquiétant, cynique et bravache, auquel il s’adaptera à merveille.
– Et votre vedette féminine ?
– Dita Parlo, l’actrice qui travaille maintenant sous la direction de Kirsanoff pour La Séparation des races, adaptation du roman de Ramuz.
– Nourrissez-vous d’autres projets?
– Certes, j’ai notamment un « script » élaboré en collaboration avec Jean Painlevé et qui s’intitule Le Café du Bon Accueil. J’espère pouvoir l’extraire d’ici peu de mes cartons. Car la chance m’a toujours servi.
Savez-vous comment je suis venu au cinéma ? Malade, je fis un long séjour à Nice. J’eus l’occasion de pénétrer dans les ateliers de prises de vues niçois en qualité d’assistant opérateur. Puis ce fut mon premier film. Un documentaire : A propos de Nice. Je le réussis grâce à l’aide précieuse de mon excellent cameraman Boris Kaufman, le frère du cinéaste russe Dziga-Vertoff. On s’accorda pour reconnaître des qualités à ma pellicule. Un soir, à Paris, on me propose de réaliser un documentaire sur la natation. J’ignorais tout de ce sport. N’empêche, en vingt-quatre heures, j’effectuai un découpage qui fut accepté. Il ne me restait plus qu’à enregistrer les mouvements exécutés par le champion Jean Taris dans une piscine à hublots. Taris est, par manière de parenthèse, d’une extrême obligeance. Aussi n’ai-je rencontré aucune difficulté. Vous connaissez le résultat de mon incursion dans un domaine jusqu’alors ignoré de moi.
En ce qui concerne Zéro de conduite, la chose fut moins simple. J’en avais le sujet en tête, rien de plus. Il fallut commencer quand même, en raison de circonstances indépendantes de ma volonté, comme on dit. Au fur et à mesure de l’avancement du travail, je préparais les scènes à faire se dérouler devant l’objectif. C’est une méthode que je ne recommande à personne. Pour moi, j’avais autour de moi une équipe de camarades admirablement dévoués. Et tout d’abord votre compatriote Henri Storck dont j’admire le simple et si sincère talent. Puis mon vieux compagnon de A propos de Nice, Boris Kaufman, mes assistants Albert Riéra et Pierre Merle. Et tous les autres : accessoiristes, électriciens.
Il me faut insister sur le concours que m’a apporté le musicien Maurice Jaubert dont certaines innovations ont de quoi étonner les spécialistes les plus avisés : celle qui consiste par exemple à écrire un thème — celui de la retraite aux lampions — à l’envers en recommandant de monter la « boucle-son » à l’encontre de sa position ordinaire. Ce qui confère à la reproduction un volume étrange et comme aspiré où les images trouvent une parfaite équivalence. En outre, Jaubert sait le cas échéant sacrifier sa partition aux nécessités de l’ensemble, à des cris d’enfants ou à tout autre motif harmonique…
– Encore une question. Votre jugement sur la production « Made in U.S.A. » ?
– On édite là-bas maints films – ceux qui ont trait à des sujets sociaux notamment – dont on devrait s’inspirer chez nous. Mais n’oublions pas qu’il s’agit le plus souvent de pure propagande politique et non d’expressions d’un ordre intellectuel mieux organisé que le nôtre. Mais j’admire beaucoup des œuvres telles que Je suis un évadé (de Mervyn LeRoy.ndlr), œuvres constituant d’indiscutables réussites.
– A quelles formules cinématographiques vont vos préférences?
– Pour être complet dans ma réponse, il me faudrait remonter à Méliès et à Mack Sennett. Mais, vraiment, cela nous entraînerait trop loin…
Et Jean Vigo nous a tendu la main en ajoutant dans un sourire :
– Ne me vieillissez pas trop…
1933.
Pour Vous, 30 novembre 1933.
Reproduit dans Jean Vigo de Pierre Lherminier, ed.Seghers.1967.
QUAND JEAN VIGO TOURNE « L’ATALANTE » par CLAUDE VERMOREL
Vraiment, m’a écrit Jean Vigo, tu veux venir nous voir jouer aux cinéastes ?
Il a raison. D’habitude, ça n’est pas drôle. On attend des heures celle de savoir que dans un prochain film une boniche « accorte » dira qu’ « elle est servie » ou qu’ « un Monsieur la demande » à une dame qui justement était en train d’admirer son indéfrisable oxygénée dans la luxueuse psyché d’un boudoir de luxe…
Cependant que le metteur en scène vous entretient de son génie, la jeune première de son « art », les figurants de la façon curieuse et digne de mémoire dont ils soignent leur eczéma « un truc qu’ils tiennent de … vous savez bien, le type qui jouait dans…, oui c’est moi qui y fais le … » On a vite besoin de changer d’air.
Jean Vigo tourne sur une péniche. Mais oui, comme tout le monde, il se sert de caméras, de sunlights, de soundmen.
Le film s’appelle Atalante. L’Atalante, c’est la péniche. Il y a aussi une noce, des choses qui se passent dans la brume, de la vraie ou de l’imitée, des chats. C’est tout ce que je sais : je n’ai pas demandé qu’on me révèle l’histoire. Les histoires de ciné !
Et puisque c’est Jean Vigo qui la raconte ! Jean Vigo n’a tourné encore qu’un grand film : Zéro de conduite. La censure l’a interdit. On n’a jamais bien sû pourquoi. Elle non plus. Mais ça vous pose un bonhomme de ne pas débuter par des vaudevilles bien roses. Vigo n’a d’ailleurs pas fait ça pour se signaler (il est si simple !) mais parce qu’il pense qu’il est naturel de se vendre, même lorsqu’on crève de faim.
Il y a aussi Dita Parlo, une actrice – on aimerait mieux dire une jeune femme – très intelligente (que de neuf dans ce film !), très sensible, très naturelle, et qui pense et dit qu’une star ne vaut que ce que vaut son directeur.
Et puis Michel Simon, ce non-conformiste qui pour faire un signe de croix sait avoir l’air plus cafard qu’un homme noir de Genève ce – comment dire : lettré ? c’est trop rat de bibliothèque ; cultivé ? c’est trop amateur – ce type comme il y en avait au temps de Rabelais et pour qui rien d’humain n’est étranger, dont on croirait que tous les jours il descend l’escalier de la berge avec sa casquette de marinier, son tablier rapiécé, son cabas de provisions d’où pend un poumon rose pour ses chats.
« Eh bien, les mignons ! c’est bon, ça. Mange donc, toi, sacrée charogne ! » Devant lui, marche le gosse de Zéro de conduite, l’air buté ; mauvaise tête, doit dire son prof, s’il en a un, car il ne peut pas s’empêcher d’injurier tout ce qui porte un col raide ou une casquette galonnée.
Vigo, creusé, fiévreux, et qui n’a rien mangé depuis le matin (il est cinq heures) – « Faut pas être trop exigeant, dit-il, j’ai mangé hier » – barbote dans une assiette de petits pois refroidis, un chat sur l’épaule, qui a eu peur des sunlights et qui s’oublie un peu partout. La folle orgie du cinéma, quoi !
Par contraste, c’est la nuit tout autour. Je me suis un peu éloigné des lumières, pour trouver, en journaliste qui sait son métier, des phrases poétiques sur le paysage, le « crépuscule piqué des premières lumières », « les usines aux fumées lourdes qui ont aussi l’air de bateaux amarrés », quoi encore ? « les reflets de la Seine qui n’est belle que dans sa brume », et puis naturellement la féerie de cette pêche aux images sur l’eau, comme en Provence, les nuits d’été…
Il y a un kilomètre de foules pour voir ça, qui doivent être là depuis le matin, des boutiquiers qui se relaient, tous les passants qui étaient sûrement pressés, à six heures, des petites filles éblouies (« Regarde-le… si, si, c’est Michel Simon ») et des sergents de ville tout fiers de leur droit d’être au premier rang et qui, de temps en temps, mettent un peu de désordre dans cette foule bien sage.
Pour Vous, n° 289, 31 mai 1934.
Reproduit dans Jean Vigo de Pierre Lherminier, ed.Seghers.1967.
ÉLIE FAURE : UN CINÉASTE-NÉ
La revue Pour vous, qui publiait ce texte le 31 mai 1934, le faisait précéder du « chapeau » suivant : « Historien de l’art, philosophe et essayiste de grande classe, le docteur Elle Faure est un des hommes qui, en France, ont les premiers compris l’importance du cinéma et ses possibilités infinies. Il nous annonce aujourd’hui la naissance d’une oeuvre originale, L’Atalante, et nous dit sa sympathie pour la personnalité de son auteur, M. Jean Vigo. »
« Les Français, a dit René Clair, le plus constamment heureux sinon le meilleur de nos cinéastes, ne comprennent rien au cinéma. » C’est vrai. Pourquoi ?
Peuple plus loquace – sinon écouteur – que visuel. Bavard, ou plutôt aimant le bavardage, et le bavard.
Eprouvant toujours le besoin de traduire l’image en mots, chose assez choquante, et probablement impossible, quelque peu sotte par surcroît. D’abord sensible au développement dialogué d’une intrigue romanesque, et par là indifférent à la beauté d’un éclairage, d’un rythme, d’un contraste, d’un volume, d’un passage, réalités pourtant nécessaires et suffisantes à définir le cinéma.
C’est pourquoi les vrais cinéastes français sont rares, ou trop vite découragés. En voici un. Et son bilan devrait suffire à le classer. Jean Vigo ? Un film oublié, parce qu’inattendu. Un film interdit, parce que d’une pensée trop amère, et subversive. Un film non encore projeté. Pourquoi ? A propos de Nice, Zéro de conduite, L’Atalante.
Je ne retiens que le dernier, puisque le premier est muet, et que les films muets ont à tel point cessé de plaire – aux spectateurs ? je n’en suis pas très sûr, en tout cas aux directeurs de salles – que le génial Charlie Chaplin est redescendu vivant dans les limbes. Puisque le second ne peut atteindre un public protégé contre la pensée par une institution qui croit représenter l’ordre et ne représente que la peur.
L’Atalante ? De l’humain. De l’humain chez les pauvres gens.
En chandail et camisole. Pas de cristaux étincelants sur la nappe. Des torchons qui pendent, des casseroles. Des baquets. Du pain. Un litre. Des lueurs humbles dans la demi-obscurité accrue par les brouillards du fleuve. L’ombre furtive de Rembrandt qui se rencontre, entre des meubles rugueux et des cloisons de planche, avec l’ombre sournoise de Goya, des guitares, des chats galeux, de grossiers masques de danse, des monstres empaillés, des mains coupées dans un bocal, cet étrange parfum d’exotisme et de poésie que tout vieux marin traîne après lui dans les relents du rhum et du goudron, je ne sais quel rayon inattendu des mers illuminées dans le plus pauvre repaire. Un clown burlesque, avec sa pacotille de magie, démon pour pauvres bougres que la tentation n’avait pas touchés, parce que les bateaux sur les canaux et les rivières ne passent pas la lisière des villes.
Je songeais tout le temps à ces pinceaux de lumière promenés si loin d’eux par la couronne tournante des phares et touchant au hasard sur l’eau noire une épave, un cadavre, un paquet d’algues, ou un miroitement à la surface de l’abîme.
« Belles images, mais pas de rythme », me disait, en sortant de là, un écrivain de grande classe. Je n’en suis pas du tout certain. D’abord, depuis quelques années, nous sommes tous possédés par cette hantise du rythme importée dans une Europe encore étourdie du fracas de la guerre, et de ce mélange enivrant de somnolence et de nervosité qui l’a suivie, par la passion du jazz, des tangos, des danses exotiques, des sculptures nègres, par les progrès d’un machinisme que tant de sonorités cadencées accompagnent, et peut-être imposé à son anarchie politique par la nécessité urgente d’y introduire un ordre neuf.
En outre, il est possible que l’écran d’Amérique – notre maître, je le reconnais et le proclame – nous ait imposé son propre rythme et que nous ne sachions plus saisir, hors de lui, si précipité, si marqué, sonnant, luisant, tranchant comme des leviers et des bielles, présent dans le geste, les attitudes, le mouvement des lèvres des acteurs et l’éclair de ce couteau, et le halètement de cette motocyclette, et les vives lueurs et les trépidations de ce central téléphonique, le rythme qui nous est spécial, à nous, peuple vivant au ralenti certes, et trop statique à coup sûr, mais dont les cadences mentales ont toujours joué entre des sentiments moyens et des sensations raisonnables, et plus habitué au bruit des pas de La Fontaine qu’à celui des pas de Whitman.
Il faut se risquer, pour comprendre, à dépasser les impératifs de l’époque, à descendre au fond de soi, à gratter le vernis des habitudes et des formules actuelles, pour demander à chaque groupe humain ce qu’il peut et doit apporter à ce langage universel que nous épelons à peine. Après tout, Delacroix et Corot n’étaient-ils pas l’un et l’autre d’ici, et, chose plus singulière, contemporains ; celui-là martelant à coups de passion le dedans des choses pour en projeter la substance au-dehors, celui-ci les ramenant toutes à un mouvement secret hiérarchisé sans y paraître dans une sympathie commune, interrogeant discrètement l’ordre de l’univers au lieu de lui imposer ses désirs et de le forcer dans tous ses asiles ?
Justement, j’ai souvent pensé à Corot devant ces paysages d’eau, d’arbres, de petites maisons sur la rive calme et de bateaux qui cheminent avec lenteur devant leur sillage d’argent, à sa mise en page impeccable, à sa force invisible parce que maîtresse d’elle-même, à cet équilibre de tous les éléments du drame visuel dans l’accueil tendre d’une acceptation totale, à la perle et l’or qui recouvrent de leur voile transparent la netteté des plans et la fermeté des lignes. Et peut-être de ce fait, ai-je apprécié davantage le plaisir de respirer, dans ce cadre si net, si parfaitement dépourvu d’empâtement et de boursouflures, classique en somme, l’esprit même de l’oeuvre de Jean Vigo presque violent, en tout cas tourmenté, fiévreux, regorgeant d’idées et de fantaisie truculente, d’un romantisme virulent ou même démoniaque, bien que constamment humain.
L’Ecran Français n°22 daté du 14 novembre 1945
ZERO DE CONDUITE ET JEAN VIGO par Pierre BOST
On présente enfin au public Zéro de conduite, de Jean Vigo, film célèbre et inconnu. L’oeuvre date de plus de dix ans, elle fut interdite par la censure dès sa naissance, et depuis ce jour, les amis de Jean Vigo et du cinéma, qui se trouvaient être les mêmes, et être aussi les ennemis de la censure, se montraient le film en cachette et en parlaient beaucoup.
Nous avions raison d’en parler. Maintenant, tout le monde peut le voir. Je ne dirai pas que la bataille soit gagnée, d’abord parce qu’il est trop tard : Jean Vigo est mort à vingt-neuf ans, après une carrière difficile, qui ne fut guère soutenue que par l’amitié, ce qui ne suffit pas au cinéma.
Ensuite parce qu’on ne juge pas bien un film vieux de dix ans (la copie est, semble-t-il, imparfaite et incomplète), et surtout parce que nous ne saurons jamais ce que Jean Vigo aurait fait par la suite, les bénéfices et les leçons qu’il aurait tirés de sa propre victoire. Mais, justement, dans Zéro de conduite, ce qui est le plus émouvant, c’est peut-être, mieux encore que l’oeuvre elle-même, mieux encore que cette découverte d’un passé, l’image d’un avenir qui ne s’est pas réalisé.
L’avenir de Jean Vigo, d’abord. On l’a dit cent fois : il était l’un des mieux doués parmi les metteurs en scène de son âge, et il aurait bien fini par trouver les commanditaires et le public qu’ont trouvés les autres. Mais aussi, dans une certaine mesure, l’avenir du cinéma français.
Un homme comme Jean Vigo eût été utile à tout le monde, et justement parce qu’il était lui-même. Déjà, dans son premier film, un documentaire : A propos de Nice, il prouvait, dès le titre même, qu’il savait non seulement voir mais montrer, c’est-à-dire interpréter. Zéro de conduite en apporte la preuve : ce film, qui se déroule dans un internat de jeunes garçons, est presque, lui aussi, un documentaire, mais vivant, riche, chargé de sens, lourd d’amertume et d’ironie. La censure ne s’y est pas trompée : elle ne tolère que la satire souriante, anodine, c’est-à-dire, finalement, un peu complice.
Or Zéro de conduite est un film brusque, sans politesse, et qui passe, sans avertir, de l’aimable à l’acerbe. C’est le ton que déteste le plus la censure : elle aime bien le tout rose et elle accepte le tout noir ; dans ces couleurs-là, on sait à qui on a affaire. Tandis que, devant ces auteurs qui font rire d’un rire un peu trouble, la censure s’inquiète, elle flaire des idées de derrière la tête. Et elle a raison. Elle n’est pas si bête qu’elle en a l’air, la censure. On peut même soutenir qu’elle ne se trompe jamais.
Zéro de conduite nous montre de jeunes enfants et leurs maîtres. Les enfants font les mêmes gestes, trament les mêmes complots et sont aussi bêtes que tous les galopins de tous les collèges. Leur principal et leurs professeurs ne sont pas non plus des êtres féroces, ni sadiques ; les caricatures, ici, ne sont pas poussées plus au noir que tant d’autres… Et pourtant, il y a à travers tout le film un ton insolite, une dureté dans l’ironie, une lucidité découragée qui font un film très différent de toutes les autres histoires de collège. Ce n’est pas parce que les gamins se révoltent, ce n’est même pas parce qu’ils viennent chahuter, pendant la fête du collège, le principal, le préfet et l’abbé, que ce film a été interdit. On en a vu bien d’autres. Ce n’est pas même à cause de telle ou telle image non ; rien n’est violent dans ce film ; rien n’est vraiment cruel.
C’est à cause de l’auteur ; non pas de Jean Vigo personnellement et nommément, mais parce que derrière ce récit il y a un homme qui pense à quelque chose, au delà de ‘ses images. Ce n’est pas fréquent. Et cela fait toujours un peu peur.
En cela, il faut avouer que le public n’est jamais très loin de la censure. Zéro de conduite l’amuse, l’attire, mais aussi le déroute, l’inquiète.
C’est la seule erreur de ce film, qu’il ne fait, comme on dit, aucune concession, sinon peut-être à une certaine esthétique dont le principe essentiel est de n’en faire aucune. Il n’est pas fait pour le public, ce qui est bon ; mais il est fait un peu contre lui, ce qui est toujours dangereux.
Et puis, cela dit, Zéro de conduite est un film ravissant. Ne croyez pas à un film noir. Gai, au contraire, avec des gags éclatants, un incroyable et fourmillante richesse d’invention, ce qui est si rare en France.
Trop souvent, pour souligner la qualité d’une œuvre inconnue, sinon méconnue, on croit devoir insister sur ses intentions, sur ses arrière-plans ; et je tombe peut-être, moi-même, dans ce travers. Mais non. Zéro de conduite est un film charmant comme sont charmants tous les souvenirs d’enfance, même tristes. Les enfants n’y sont pas « mignons tout plein », mais vrais et directs, bourrés de défauts et de vertus, comme tous les enfants.
On connaît peu d’oeuvres sur la jeunesse qui réussissent aussi bien à émouvoir sans chercher à attendrir. Emil et les Détectives, de Gerhardt Lamprecht, est de la même année, sauf erreur. Encore est-il beaucoup plus imprégné d’une gentillesse un peu suspecte. Par la suite, les Américains ont travaillé la question des films d’enfants, et fort bien, dans leur style à eux. En France, on n’a jamais trouvé le vrai ton de la littérature enfantine. Jacques Darroy, dans La Guerre des Gosses, Louis Daquin, dans Nous les Gosses, sont intelligents, sensibles et justes ; mais encore rattachés à des traditions littéraires. Jean Vigo est moins adroit mais plus direct, et surtout il prend les enfants dans leur vie de chaque instant, et non pas dans leurs récréations. Dans leur vie intérieure surtout.
Je ne dis rien de la mise en scène, quoiqu’il y ait beaucoup à en dire : on remarquera avec quelle aisance Jean Vigo, dans des plans vastes, où jouent de nombreux personnages, sait montrer exactement le geste, le détail, qui doivent être vus. C’est d’une sûreté admirable.
Mais il faut bien dire un mot d’un certain sens poétique (le mot a été galvaudé) qui éclate soudain, et qui trouble presque, comme cette scène de la révolte au dortoir, où soudain le ralenti intervient pour transfigurer tous ces gamins en chemise, et fait paraître une procession de petits anges à la fois charmants et bouffons. On ne sait s’il faut rire ou y aller de sa larme. C’est ce qu’on appelle être ému.
On est souvent ému. Et jusque dans les passages qui semblent d’abord purement comiques, comme cette scène étrange où le petit pion si gentil s’essaie en secret à marcher comme Charlot… Ce gag ne vient pas par hasard. L’influence de Chaplin est évidente et avouée; celle de René Clair est visible aussi, mais sans doute moins acceptée.
Jean Vigo, tout jeune, avait des maîtres, et pourquoi non ? Sa personnalité, comme il arrive toujours, n’en était que mieux affirmée, Il inventait quelque chose.
Depuis, nous avons vu fleurir et non pas seulement au cinéma, cet humour ironique, un peu âcre, ému et sarcastique, ce rire très franc et qui se casse. C’est presque devenu un procédé, et naturellement les moyens techniques de cet art-là ont été mis au point.
Mais Zéro de conduite, film secret et important, est à l’origine de tout cela.
J’avais tort de dire que Jean Vigo n’avait pas eu son avenir. Il l’a maintenant. Son avenir, c’est le passé des autres.
P. B.
En bonus voici le court article sur cette sortie de Zéro de conduite dans le numéro précédent de L’Ecran français (n°21 daté du 21 novembre 1945).
L’Ecran Français n°120 daté du 14 octobre 1947
DEUX LETTRES DE VIGO
Voici quelque temps déjà, parlant ici-même de l’effort accompli par le C.C. de Valence sur l’impulsion de son animateur, le jeune professeur Jean Michel, nous nous promettions de publier des extraits de lettres inédites de Jean Vigo, qui avaient paru dans les Cahiers de ce même C.C. Ces lettres, adressées par Jean Vigo à l’un de ses amis : M. Pierre de Saint-Prix, étaient présentées par ce dernier en ces termes :
« Je viens de feuilleter pour vous une liasse de lettres datées de 1927 à 1930 (Jean Vigo était né en 1905). Elles sont timbrées de Font-Romeu, puis de Nice, où Vigo promène sa caméra, des ruelles de la, vieille ville à la baie des Anges… A chaque ligne on y trouve un « cœur mis à nu », exposant ses plaies vives, sans un gémissement, avec une délicatesse si déchirante qu’on hésite à transcrire. »
Je me ratatine très gauchement sur moi-même – m’écrivait-il en juillet 1928 – dès qu’on me prête par trop attention, car je ne comprendrai jamais, je crois, que l’on puisse prendre garde à moi.
Et des gentillesses encore ! Si cela m’est doux, cela me désespère beaucoup.
Loin de moi le sentiment d’humiliation, qui n’est, du reste, pas pour me déplaire. Non, ce que je ressens tient de la crainte de ne pas avoir mérité présentement, et de celle de décevoir plus tard…
C’est pourquoi mes amis me procurent les joies les plus grandes et les plus profondes tristesses…
« Créer, expliciter son imagerie intérieure, continue M. de Saint-Prix, tel est, depuis des années, l’objectif unique de Vigo. Mais, inconnu, d’humeur sauvage, comment apprendre seulement son métier ? Un des pionniers du cinéma, Mme Germaine Dulac, à qui ma mère l’avait adressé, l’accueille avec une bienveillance qui l’étonne » :
Mme Germaine Dulac m’a reçu chez elle, à Paris, très cordialement. Ses propos et son attitude respiraient la sincérité et je fus bien heureux de la rencontrer. Elle sera mon plus sur soutien à la « Franco-Film » – où elle connaît tout le monde – et où je viens d’entrer grâces à Claude Autant-Lara.
« Engagé comme aide-opérateur à la « Franco-Film «, il s’initie à la technique du « muet ». Mais c’est au service de sa propre vision, rythmée déjà en lui par une force involontaire, qu’il entend mettre sa connaissance des tours de main et des ficelles de métier. Ses rares loisirs, il les consacre à saisir au vol – une caméra d’amateur à demi-cachée sous son veston – les éléments d’A propos de Nice, qui sera sa première oeuvre personnelle : images burlesques du demi-monde cosmopolite qui étale, autour de l’ancien Casino, ses chairs fatiguées et ses fringales un peu trop neuves ; images nobles et misérables des vieux quartiers… Quelle firme osera prendre à son compte ce documentaire féroce ? »
J’ai de sérieux espoirs pour A propos de Nice, mais jusqu’aux accords définitifs, je douterai, m’écrit-il le 13 août 1930, car, je me refuse aux exercices d’assouplissement d’échine, et cela sera-t-il pour plaire ?
« Sa fière intransigeance est récompensée, Le film passe aux Ursulines. Le public trépigne, siffle, acclame. La jeunesse du Quartier latin raille les boulevardiers qui ont consenti à traverser la Seine pour assister à cette petite bataille d’Hernani. Un succès. Les studios parisiens s’entrebâillent devant le jeune « lion » 1930.
Dans la fièvre, Jean Vigo tourne Zéro de conduite, puis L’Atalante est mise en chantier… Mais, surmené, brûlé d’ardeur créatrice, toujours luttant, Vigo achève à grand’peine sa dernière oeuvre. Une endocardite infectieuse l’emporte en octobre 1934 – à vingt-neuf ans. »

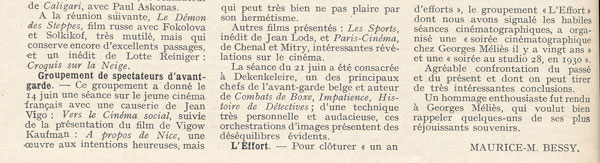
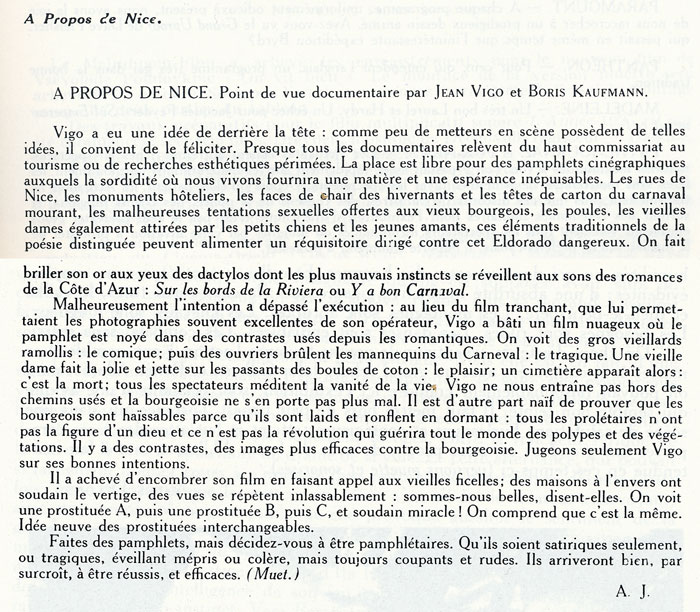





Leave a Reply